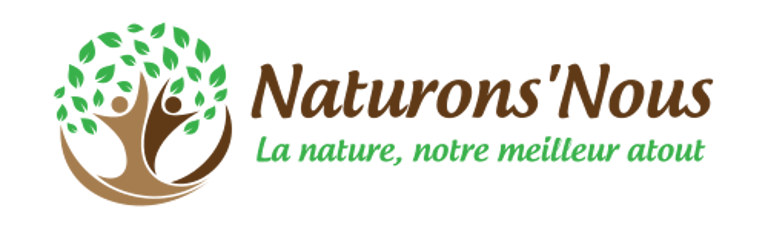Cyclone Chido : Mayotte face à une catastrophe environnementale et humaine sans précédent
FRANCE
Introduction :
Le cyclone Chido, d’une intensité historique, a frappé Mayotte le 14 décembre 2024, laissant l’archipel dévasté. Avec des vents dépassant les 220 km/h et des pluies torrentielles, cette catastrophe a causé des dégâts majeurs sur les écosystèmes, les infrastructures et la population.


Points clés :
Destruction massive : 90 % des infrastructures touchées, dont l’hôpital principal et de nombreuses écoles.
Écosystèmes ravagés : forêts détruites, récifs coralliens menacés et biodiversité en péril.
Crise humanitaire : des milliers de personnes sans abri dans le département le plus pauvre de France.
Changement climatique : un facteur aggravant lié aux eaux anormalement chaudes de l’océan Indien.
Récifs coralliens en danger
Les fortes pluies ont entraîné un ruissellement massif vers le lagon de Mayotte, étouffant le récif corallien sous une couche de boue. Ce récif abrite plus de 300 espèces marines, dont certaines pourraient disparaître définitivement. La destruction du corail compromet également la pêche locale et la protection naturelle contre l’érosion côtière.
Un désastre environnemental majeur
Forêts et biodiversité anéanties
Le cyclone Chido a rasé une grande partie de la végétation de Mayotte. Les forêts tropicales, essentielles à l’équilibre écologique de l’île, ont été presque entièrement détruites. Les grands arbres comme les kapokiers et les bois noirs ont été abattus, laissant des paysages désolés. Cette perte de couvert forestier menace gravement la faune locale, notamment les makis (petits lémuriens), les chauves-souris pollinisatrices et d’autres espèces endémiques.
Impact climatique aggravé
La disparition des forêts pourrait réduire les précipitations locales et aggraver les sécheresses déjà fréquentes sur l’île. Le cyclone Chido illustre les conséquences directes du changement climatique, amplifié par des eaux océaniques exceptionnellement chaudes.
Une crise humanitaire sans précédent
Destruction des infrastructures
Le bilan humain est lourd : au moins 22 morts confirmés et plus de 1 300 blessés. Les infrastructures essentielles, comme l’hôpital principal de Mamoudzou, sont gravement endommagées. Plus de la moitié des bâtiments dans certaines zones sont détruits ou inhabitables, laissant des milliers de familles sans abri.
Pauvreté et vulnérabilité accrue
Mayotte, déjà marquée par une pauvreté extrême (77 % des habitants sous le seuil de pauvreté), voit ses problèmes structurels exacerbés par cette catastrophe. Les bidonvilles, autrefois dissimulés par la végétation, sont désormais exposés à tous les dangers.
Risques sanitaires imminents
La destruction des infrastructures d’assainissement fait craindre une résurgence d’épidémies telles que le choléra. L’accès limité à l’eau potable aggrave encore la situation sanitaire.
Une réponse urgente nécessaire
Les secours s’organisent difficilement face à l’ampleur des dégâts. La technologie spatiale du programme Copernicus aide à cartographier les zones sinistrées pour prioriser les interventions. Cependant, la reconstruction prendra des mois, voire des années.
Cette catastrophe met en lumière la nécessité d’une justice climatique pour les territoires ultra-marins comme Mayotte. Le dérèglement climatique amplifie ces événements extrêmes, rendant indispensable une action internationale pour réduire les émissions globales tout en soutenant les régions vulnérables.
Sources :
RFI
France Info
TV5 Monde