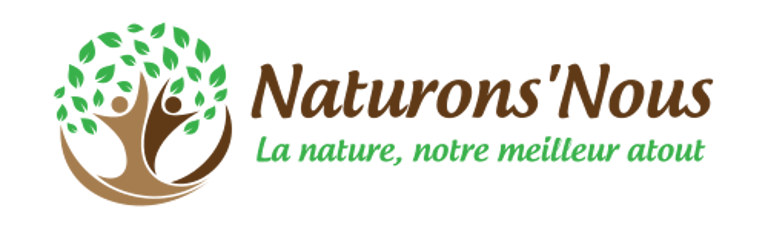Dernière chance pour un traité mondial contre la pollution plastique : enjeux cruciaux à Busan
MONDE
Introduction :
La conférence mondiale sur la pollution plastique à Busan marque une étape décisive pour l'avenir de notre planète. Les négociations visent à enrayer une crise environnementale et sanitaire majeure, mais les divisions entre pays menacent un accord historique.


Points clés :
La production mondiale de plastique pourrait doubler d'ici 2040, aggravant les émissions de gaz à effet de serre.
Plus de 90 % du plastique n'est jamais recyclé, et 20 millions de tonnes finissent chaque année dans la nature.
Deux visions s'opposent : une approche globale sur le cycle de vie des plastiques contre une gestion limitée aux déchets.
Un échec coûterait jusqu'à 281 800 milliards de dollars d'ici 2040 et aurait des impacts irréversibles sur la biodiversité et la santé humaine.
Un défi mondial au cœur des négociations
La cinquième et dernière session du Comité intergouvernemental de négociation (INC-5) s'est ouverte à Busan, en Corée du Sud, réunissant 178 pays pour discuter d'un traité mondial sur la pollution plastique. Cette conférence est considérée comme une "dernière chance" pour parvenir à un accord ambitieux, après quatre cycles marqués par des désaccords profonds. Le diplomate équatorien Luis Vayas Valdivieso, président des débats, a souligné l'importance historique des décisions à venir, qualifiant cette mobilisation d'ultime réponse face à une "menace existentielle" pour l'humanité.
Les enjeux financiers et environnementaux
L'inaction face à la pollution plastique pourrait coûter entre 13 700 et 281 800 milliards de dollars d'ici 2040 en raison des impacts combinés sur l'économie mondiale, la biodiversité et la santé humaine. Les écosystèmes marins sont particulièrement menacés par les déchets plastiques qui perturbent les chaînes alimentaires et détruisent les habitats naturels.
Sur le plan sanitaire, les microplastiques présents dans l'environnement se retrouvent dans nos aliments et notre eau potable. Leur ingestion est associée à des risques accrus pour la santé humaine, notamment des perturbations endocriniennes et des maladies chroniques.
Vers un accord ou un échec ?
Malgré l'urgence climatique et environnementale, les chances d'un accord ambitieux restent incertaines. Les divisions entre pays reflètent non seulement des intérêts économiques divergents mais aussi une lutte plus large entre développement durable et dépendance aux combustibles fossiles.
Cependant, cette conférence représente une opportunité unique pour établir un cadre global capable d'enrayer la crise plastique. Comme l'a souligné Inger Andersen du Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE), "le moment est venu d'agir pour protéger notre avenir collectif".
Des visions opposées : deux camps face à face
Les débats à Busan mettent en lumière deux approches diamétralement opposées :
La Coalition des hautes ambitions (HAC) : Composée principalement de pays africains, européens et asiatiques, cette coalition milite pour un traité couvrant l'ensemble du cycle de vie des plastiques. Elle prône des objectifs contraignants visant à réduire la production et les déchets plastiques tout en favorisant une économie circulaire. La HAC insiste également sur l'interdiction des substances chimiques toxiques et sur le principe du pollueur-payeur.
Les grands producteurs pétroliers : Des pays comme la Russie, l'Arabie saoudite et l'Iran défendent une approche plus limitée centrée uniquement sur la gestion des déchets. Ils rejettent toute mesure contraignante sur la production ou les substances chimiques, arguant que cela nuirait à leurs économies dépendantes du pétrole.
Ces divergences ont paralysé les précédents cycles de négociations, aboutissant à un projet de traité jugé irréalisable par plusieurs observateurs. Pour débloquer la situation, un texte simplifié de 17 pages a été proposé par M. Vayas Valdivieso afin de recentrer les discussions sur des terrains d'entente tels que le développement des plastiques réutilisables.
Un problème aux dimensions catastrophiques
En 2019, la production mondiale de plastique atteignait 460 millions de tonnes, un chiffre qui a doublé depuis l'an 2000. Si aucune action n'est entreprise, cette production pourrait encore doubler d'ici 2040. Pire encore, plus de 90 % des plastiques ne sont jamais recyclés, et leurs effets se font sentir partout : dans les océans, les sols, l'air, et même dans le corps humain sous forme de microplastiques détectés dans le cerveau ou le lait maternel.
Le plastique représente également environ 3 % des émissions mondiales de carbone en raison de sa fabrication à partir d'énergies fossiles. Selon l'OCDE, ces émissions pourraient doubler d'ici 2050 si la production continue sur sa trajectoire actuelle.
Sources :
Le Parisien
UNEP
France24
Ministère français de la Mer
France Info
L’Express